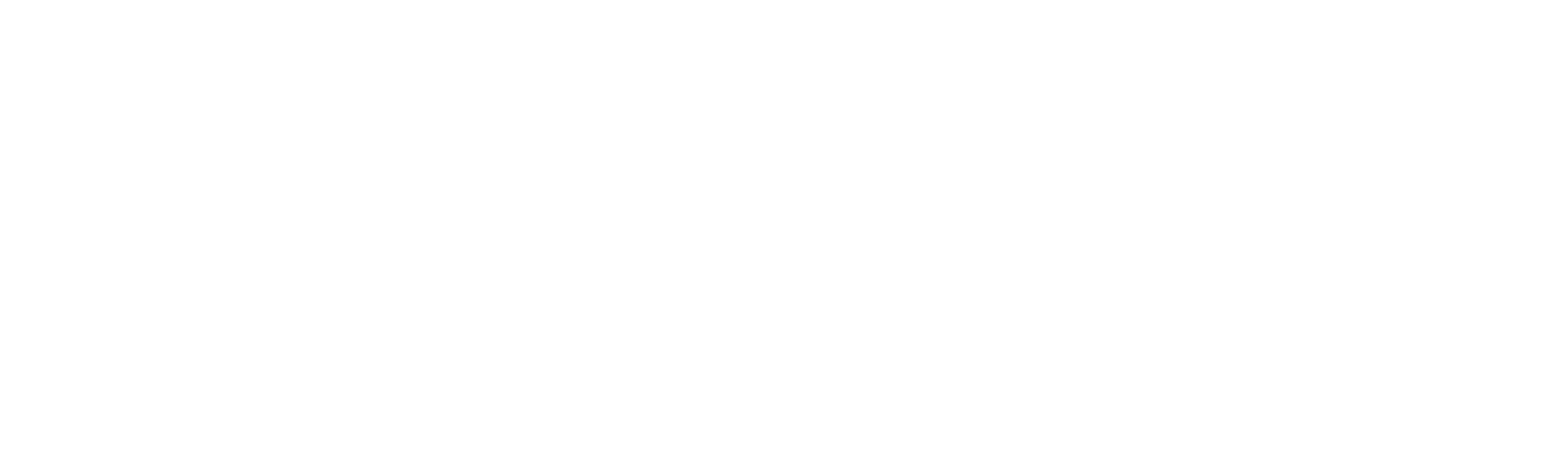Fahd Nakib
Titre de la Thèse: Pomponazzi et l’usage des ‘Topiques’ à la lumière de ses enseignements
Courriel: fahd.nakib@etu.univ-tours.fr
Date de début de la thèse: 2017
Date de soutenance: Mercredi, 10 Avril, 2024
Directeur (trice): Joël Biard
Résumé:
Discipline : Philosophie
Nous nous proposons d’étudier le mode d’argumentation du philosophe italien Pietro Pomponazzi (1462-1525), son usage de la dialectique, aussi bien dans ses traités que dans ses enseignements.
Consigné et codifié par Aristote, le raisonnement dialectique, par la nature des objets qu’il se donne autant que la forme qu’il revêt, n’a pas vocation à égaler la scientia ou certitude démonstrative, mais tend à remporter l’adhésion de l’auditoire en gagnant sa conviction (fides) moyennant la maîtrise sans faille d’une technique argumentative aussi cohérente que possible. Nous nous attachons à examiner ce que dit Pomponazzi des Topiques mais également les usages qu’il en fait, afin de faire ressortir les liens entre l’argumentation et les types d’assentiment qu’elle suscite. C’est donc une variation sur un thème fondamental, celui du rapport entre connaissance et croyance, dont il s’agit de montrer l’originalité d’une approche qui propose des modalités inédites de leur relation.
Pour ce faire, nous nous tournons vers le traité sur l’immortalité de l’âme, mais surtout vers le corpus professoral de Pomponazzi. L’objectif est d’apprécier un dispositif argumentatif que nous percevons dans les traités, de sorte à pouvoir appréhender l’intuition qui préside à la démarche.
Si notre étude trouve son point de départ dans la démarche d’un auteur comme Pomponazzi, elle s’attache moins à dresser le portrait d’un philosophe à partir de projections historiographiques qu’à en évaluer la portée philosophique, et fournir ainsi un éclairage ponctuel sur les liens entre la philosophie de la Renaissance et les traditions médiévales.